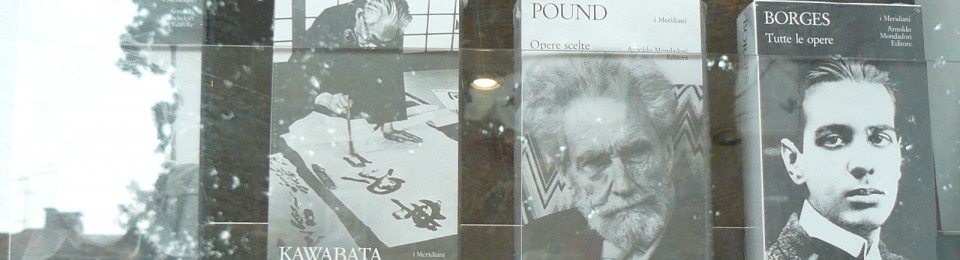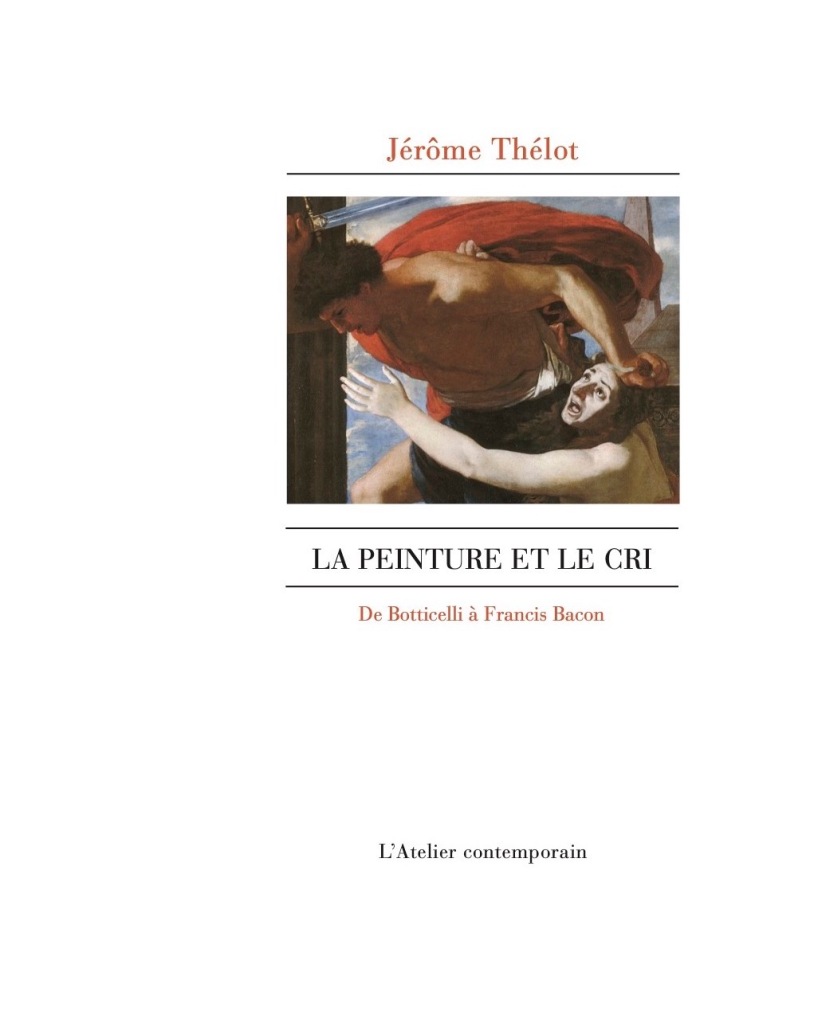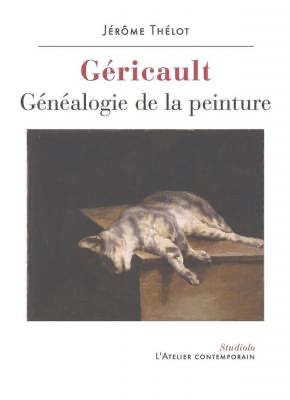Étiquettes
époque, Descartes, Frans Hals, Hammerstoi, Jérôme Thélot, L'Atelier Contemporain, peinture, utopie, Yves Bonnefoy

C’est un livre que, sans doute, l’on pourrait dire décisif que celui que Jérôme Thélot nous propose aujourd’hui. On n’ouvrira donc pas « L’époque de la peinture, prolégomènes à une utopie » (éditions L’Atelier Contemporain) comme « un livre de plus. » Sans doute est-il singulièrement ambitieux. Dans son intention. Ou plutôt dans le propos qu’il affirme d’entrée, si toutefois on n’en voit que la lettre :
« Que peut, au juste la peinture ? (c’est l’auteur lui-même qui souligne et qui poursuit ainsi) : Ce livre forme l’utopie d’un monde qui probablement n’aura jamais lieu, d’un monde qui eût été, ou qui serait, configuré par la peinture. » Le lecteur pourrait se demander pourquoi tel projet. Et l’utopie, la croire, en effet, en elle-même, tellement improbable, que, se demandant s’il y a là quoi que ce soit de « réaliste, » il est bien nécessaire de s’engager sur un tel chemin. Mais voilà : sur cette voie il se trouve déjà. Et il ne cessera très certainement de la parcourir, avec la plus grande attention, là-même où il sera saisi par ce que l’on pourrait appeler « l’évidence » du propos.

Il n’est pas lieu ici de retracer le parcours, escarpé, parfois ardu, ardent tout aussi, que nous sommes amenés à faire, guidés par des œuvres connues de tous ou aussi beaucoup plus « discrètes, » emportés plus encore par la pensée de Jérôme Thélot. Il n’y a pas de raison de retracer cette route car seul, assurément, le livre lui seul, peut le faire. Et chacun de nous alors, en être aussi, en lecteur attentif, l’inventeur. Dans la mesure-même où ce que nous découvrons c’est toujours ici comme si nous le redécouvrions. Car, il faut le dire, cette « utopie » est une évidence. Et une évidence qu’il faut entendre au sens premier, une vérité initiale par conséquent. Elle n’est donc pas un projet qui s’imposerait à nous comme un but à atteindre quoi qu’il advienne. Mais elle nous dit ce qu’est la peinture. « Sa tâche n’est que d’exalter l’essence de la peinture qui la rend apte à fonder l’utopie d’une restauration de la terre ruinée par la technique, » écrit Thélot en regard du saisissant tableau du peintre danois Hammershøi « Vue de Refsnœs. »
Parce que si la peinture peut « fonder une utopie » c’est bien ce qu’elle est, précisément en son fondement premier qu’elle dispose de ce pouvoir.
La peinture est ici cet art qui est à même de montrer le chemin de la fondation d’une époque, c’est-à-dire d’un autre monde, autre que celui qui le précède et qui est donc cela que nous vivons comme époque présente et qu’il définit ici comme époque de la technique. Ce que nous comprendrons en partie avec Heidegger mais aussi avec une actualité que l’on peut sans doute considérer comme de même nature, en tout cas tout aussi menaçante, l’avenir de la Terre elle-même, voire son présent déjà, semblant mis en cause à chaque crépuscule.
Et, peut-être, pourrait-on se référer ici, pour tenter d’éclairer l’hypothèse même de ce livre, propos qui peut sembler étrange, audacieux, presque « irréel » même, par un mot du poète Yves Bonnefoy qui ne désigne, ni dans le même contexte, ni dans la même perspective, la peinture comme source de l’utopie d’une « époque » par ce qu’il dit en 2007 :
« Toute décision du pinceau sur une toile met en mouvement des mots dans le peintre, elle en modifie la pensée, elle engage son avenir. » (« Sur la création artistique » in »L’inachevable » Albin Michel 2010)
Ici, il faudrait assurément comprendre très précisément ce que Bonnefoy désigne comme « la décision du pinceau. » Car enfin, on pense plutôt que c’est le peintre qui décide, pas cet objet ; cet objet qu’est, sans aucun doute possible, ce que l’on nomme un pinceau. Seulement un objet. Rien de plus. Mais sans doute Bonnefoy veut-il nous dire qu’il y a dans le geste du peintre, non pas le produit d’une réflexion, mais à l’inverse quelque chose d’immédiat dont le pinceau est l’acteur, là où il ne se distingue pas, précisément, de l’acte lui-même, du peintre tout entier, en ce qu’il ne reproduit pas une image, mentale, ou une réalité re-présentée, ni même celle d’une forme ou d’une couleur. La peinture est ainsi désignée par cette extraordinaire « décision du pinceau » comme un acte originaire, fondateur, premier.

C’est sous d’autres perspectives, par d’autres parcours que Jérôme Thélot nous montre tout au long de ce livre que l’époque que la peinture se distinguant du présent, s’y opposant, le réfutant, sera une époque qu’il dit « gaie ». C’est ainsi que l’on trouvera dans « L’époque de la peinture » une admirable analyse d’un portrait du philosophe René Descartes par Frans Hals. Nous faisons souvent de ce dernier l’exemple du philosophe de la raison et ainsi de la raison qui est une représentation du monde, un savoir ou une science si l’on veut. Et le « cogito » tout le monde sait de quoi il s’agit. En tout cas le mot de Descartes a fait, si l’on peut dire, le tour du monde. Mais le cogito cartésien ne désigne pourtant pas la conscience représentative. Bien plutôt il nous dit à peu près l’inverse, pour l’affirmer brutalement. Et Jérôme Thélot, en référence à Michel Henry qui écrit (« Videre videor » pp 52 in « Généalogie de la Psychanalyse » PUF 1985) : « La régression vers le premier apparaître et vers le commencement s’est faite dans le cogito non point à partir d’un mode spécifique de la pensée, de l’entendement…par l’acte obscur et la passion infinie d’une volonté aveugle, rejetant d’un geste tout l’intelligible…La pensée la plus initiale,entrevue par Descartes à l’aube de la culture moderne, n’avait justement rien à voir avec celle qui allait guider cette culture, par le biais des théories de la connaissance et de la science vers un univers comme le nôtre…Cette pensée inaugurale…dans la subjectivité radicale de son immédiation à soi-même, méritait un autre nom, que Descartes lui donna d’ailleurs, le nom d’âme ou, si l’on préfère, le nom de la vie. »
Aussi, nous lirons sous la plume de Thélot, après qu’il nous eut montré le portrait du philosophe : « Peindre conformément au commencement indubitable, c’est voir ainsi : non seulement voir mais se sentir voyant – c’est l’auteur qui souligne – et se sentir gai de ce sentir lui-même, du coup produire ensemble la couleur et la forme. Telle se comprend la gaieté :
« Nous sommes, nous savons que nous sommes et nous aimons – id supra – cet être et cette science qui est en nous » comme l’écrit Descartes lui-même. (Lettre novembre 1640 éd. Adam-Tannery, III, p. 247, éd Vrin 1966).
Il faut ainsi reconnaître que toute utopie est gaie ou alors elle n’est pas et elle est seulement vouée à se dissoudre elle-même. S’il y a utopie c’est que quelque chose ne suffit pas, ne va pas, que le monde est triste, ou horrible, ou désespéré. Peu importe. Mais la gaieté qui a pour ambition de refonder ce monde-ci ne peut précisément trouver sa source que dans un monde heureux. Un monde « gai » désormais peut s’ouvrir et apparaître. Mais enfin, il ne sera gai, véritablement gai, à la fois dans son fondement et dans son avènement, que dans un effort qui est aussi une volonté. Et ce que l’on a dit parfois « un travail. » Ou plus encore au travers d’un labeur, sans fin recommencé, qui est celui de la vie dans le monde et qui, désormais appuyé sur son socle premier, celui de la gaieté s’il faut le redire, est un bonheur, et une joie pourtant. Incessants toujours.

On peut bien sûr se poser la question de savoir s’il n’y a pas ici une « utopie » au sens le plus banal du terme (« un rêve » et seulement cela dans ce cas) et surtout à dire que la peinture serait cette utopie (au sens fondateur). Les dernières phrases du livre de Jérôme Thélot répondent à leur manière à cette interrogation. Il me semble qu’il ne faut pas ici les dévoiler, que rien ne serait plus maladroit : tout livre doit garder sa part de mystère, son suspens si l’on veut. Mais, si la peinture peut, au travers des développements inouïs qui nous sont ici proposés, nous faire apercevoir au moins un chemin, ou même seulement, la possibilité de celui-ci, celle d’une époque nouvelle, il faut alors apprécier la lecture de « L’époque de la peinture » à sa juste valeur. Car elle est la plus essentielle qui soit.